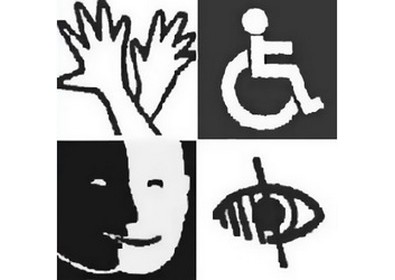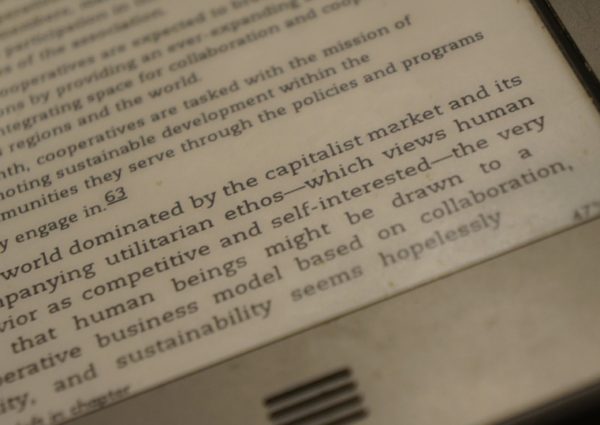La cueillettes des mûres
Personne sur le chemin, et rien, rien sinon des mûres,
Des mûres de chaque côté, des mûres partout,
Une allée de mûres, qui descend en crochets, et une
mer
Quelque part au bout, qui se soulève. Des mûres
Aussi grosses que mon pouce, aussi muettes que des
yeux
Ébène dans les haies, et pleines
De jus bleu-rouge, qu’elles abandonnent sur mes doigts.
Je n’avais pas demandé de telles sœurs de sang ; elles
doivent m’aimer.
Elles sont accommodantes, elles se font toutes petites
pour tenir dans ma bouteille à lait.
Là-haut passent les chocards en volées noires,
cacophoniques-
Bouts de papier brûlé qui tournoient dans un ciel
orageux.
Leur voix est la seule voix, elle proteste, proteste.
je ne crois plus que la mer apparaîtra.
Les hautes prairies vertes s’embrasent, comme
illuminées de l’intérieur.
J’atteins un buisson de baies si mûres que c’est un
buisson de mouches,
Suspendant leurs ventres bleu-vert et leurs ailes en un
paravent chinois.
Le sirupeux festin de baies les a tout étourdies ; elles
croient au paradis.
Un crochet encore, et les baies et les buissons finissent.
Il ne manque plus que la mer maintenant.
D’entre deux collines un vent soudain s’abat sur moi
et me gifle le visage de son linge fantôme.
Ces collines sont trop vertes et douces pour avoir
goûté le sel.
J’emprunte le sentier aux moutons qui les sépare. Un
ultime crochet me mène
A la face nord des collines, et cette face est de roc
orange
Et ne donne sur rien, rien sinon un grand espace
de lumières, blanches et d’étain, et un vacarme comme
d’orfèvres
frappant, frappant encore un métal intraitable.
Sylvia Plath, Arbres d’hiver, Ed. Poésie/Gallimard
Bien à vous.
Géraldine